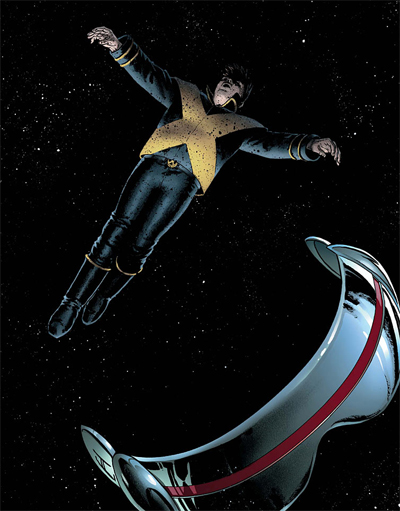Le vendredi, c’est difficile. J’ai toujours ressenti davantage la fatigue le jeudi soir, quand la semaine a déjà bien semé son sillon lent de par mon implication laborieuse voire productive selon le logiciel idéologique. Mais le vendredi matin, c’est le moment où et quand je m’accorde une pause d’hébétude entre existentialisme et désir d’expression écrite. Donc blog, rapido, car écrire demeure un exercice salutaire qui est devenu une part signifiante de la discipline que je me suis doucement imposée.
Alors… Au Liban, une « attaque » inédite, avec le piégeage d’appareils qui ont littéralement explosé à la tête ou dans les mains de leurs utilisateurs. Entre la guerre en Ukraine et le massacre au proche-Orient, difficile de discerner la réalité des enjeux et des motivations dans tout ce bordel dont, à distance et via des médias très sélectifs, nous ne voyons que la crête du coq. J’ai toujours eu un souci avec tous les films américains qui mettent en scène des psychopathes qui finissent par se faire avoir par un héros malin qui retourne contre eux leurs sinistres manipulations, notamment émotionnelles.
Le mal par le mal, j’ai du mal. Je continue de penser, comme je l’ai toujours seriné à mes enfants, qu’il est dangereux d’agir petitement face à un petit. Ce matin, j’ai vu que la population au Liban est entrée, très logiquement, dans une psychose, et c’est compréhensible car pour des questions ou des légitimations tactiques, on évite d’utiliser le mot « terrorisme ». Ce qui m’effraie, c’est qu’à part un seul podcast, toujours Tocsin que je recommande à tous ceux qui veulent de l’info non prédigérée, Jacques Baud a osé le mot, celui qu’on aura voulu extorqué il y a près d’un an à un certain parti politique qui voulait recentrer le débat autour d’un conflit maintenant multi-décénal en ne le proscrivant pas à un acte solitaire et monstrueux.
Je continue de penser, très naïvement sûrement, qu’un civil innocent, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité, est un mort de trop. Ah oui, la guerre c’est sale, il faut arrêter la candeur coupable, faut arrêter cette miséricorde de façade, cette empathie facile. Mais bon, je vous emmerde, la guerre c’est la faillite de l’Humanité, et ne pas voir le commerce et les raisons qui la motivent révèlent beaucoup de ce que vous êtes vraiment. Je suis et je resterai toujours un indécrottable pacifiste, même si j’irai faire la guerre contre tous ceux qui oublient les notions élémentaires d’humanité. Hors, ces guerres là n’existent pas.
Ce n’est pas la volonté du bien et de la Justice qui motive les conflits. J’ai adoré, j’adore toujours, Helldivers 2 pour son humour très Starship Troopers avec la défense de la démocratie. Toute oeuvre, même la plus inoffensive, est politique, car elle induit toujours un message, invitant au conformisme ou à la dissidence. Et s’il y a bien un mot qui aura été bien abîmé, qui aura été vidé de son sens, vampirisé par tous ceux qui s’en sont servi pour déguiser leurs réelles motivations, c’est bien le mot « démocratie ». Combien de morts civils pour offrir la démocratie aux barbares qui continuent de vouloir peupler le monde ? Trop. Je ne suis pas expert des conflits au proche-Orient, je suis trop loin pour prendre parti, je suis rétif à adhérer pleinement aux invitations à haïr aveuglément, même des fanatiques ou des salauds misogynes. Quand je regarde certaines images, je vois des gosses mutilés, je vois des femmes éplorées, je vois des hommes hagards, errant dans des décombres ou penchés sur des corps. Participer à ça ou le déplorer ? Une pensée ce matin pour tous ceux, dans tous les camps, qui œuvrent à préserver les solutions les plus pacifistes et les plus constructives. Je sais qu’il y en a dans tous les camps, dans tous les peuples, dans tout ce qui fait qu’un groupe d’humains font société… et ils ont beaucoup à faire pour tenter de ramener un peu d’ordre dans cette folie. Pendant ce temps en France, on vocifère et on nous encourage à baver de fureur ou à jouir d’un sombre contentement. Les mots sont dévoyés, constamment des experts refont les définitions, déterminent le curseur où placer la limite entre le bien et le mal. Petite pensée pour cette éditorialiste qui a voulu expliquer qu’un enfant mort n’en est pas un, ne se considèrant (in fine) qu’avec le filtre de la qualification entre une bonne et une mauvaise victime. Une bonne victime c’est celle qui est sacrifiée pour l’avènement du bien. Une mauvaise victime c’est dans le camp détenteur, monopole précieux, du bien. Ces gens là sont devenus les terrassiers d’un enfer résolument pavé de « très » bonnes intentions. Pas de plage sous ces pavés là.
Cui bono ? Toujours. Certains experts expliquent que la volonté est de pousser au crime, de pousser à la faute, pour justifier, ensuite, la répartie violente. L’air de rien, nous vivons une époque incroyable de tensions larvées. Une guerre économique, mondiale, qu’en France nous continuons de n’en voir qu’un manichéisme facile. Les bons, les méchants, les démocrates et les autres, la fameuse guerre de civilisation. La France est en train de crever de cette hypocrisie qui s’est installée durablement de manière systémique. Comme si tout ça, toute cette gloriole idéologique n’était finalement qu’un vernis qui couvre, qui camoufle, de moins en moins, la réalité du pourrissement. Hier, mon fils est venu défendre Ruffin. Je n’ai absolument rien contre ce héraut de la gauche, mais j’ai tenté d’expliquer que la LFI et donc Ruffin qui n’en est plus, ne sont pas les révolutionnaires qu’ils prétendre être. Oui, ils veulent réformer le système, mais absolument pas le changer. Leur révolution, c’est la continuité de celle de 1789.
Ce qui ne suffira pas, ce qui ne fera que des ajustements à la marge. J’en reste convaincu, la seule révolution qui peut changer les choses, c’est une révolutions des esprits, c’est une évolution de la perception. Sortir de l’impasse des idées reçues, des certitudes et des croyances, pour oser interroger la moindre chose que nos sociétés ont sacralisé pour nous rendre à la fois aveugles, serviles et zélés. Tous ceux qui instrumentalisent la lutte contre l’extrême-droite pour obtenir leur « légitimité » l’ont bien compris. Pour revenir à Ruffin, il faut lui accorder qu’il a bien perçu la scission des « publics » qui définissent la réalité du peuple français. Cette synecdoque qu’on nous rabâche à chaque sondage, avec « les Français », comme si nous étions tous unis, tous pareils, tous semblables, tous égaux. Mais Ruffin est un productiviste basique, il y a dans cette gauche l’acceptation d’une organisation sociale qui induit un assujettissement et une domination. De la continuité, donc. En cela, ces mouvements de gauche ne sont absolument pas révolutionnaires, et il faudrait déjà constater les limites et les compromis de la révolution de 1789. pour initier une nouvelle étape, pour oser vouloir créer, sociétalement, autre chose.
Je sais, je suis un rêveur. Je resterai un anarchiste, au pur sens du terme, « an-arkos », « sans chefs ». Les Hommes (et les Femmes) ont besoin d’ordre, ont besoin de lois, ont besoin de règles et de cadres, pour ne pas finir par s’entre-tuer. C’est dans ce constat que repose toute ma tristesse et ma tranquille désespérance. Ce vendredi matin, j’en fais encore le constat. Ce qui ne m’empêchera pas de bosser, une fois ces quelques mots balancés au vent digital, dans le presque vide numérique, cette matière noire qui remplit nos vies d’un néant confortable car nous procurant l’illusion d’une galaxie remplie d’étoiles… et dont je ne serai toujours qu’une rapide et insignifiante étoile filante ne laissant dans son sillon qu’une lumière diffuse et mourante.
Oui, j’aime Victor Hugo.